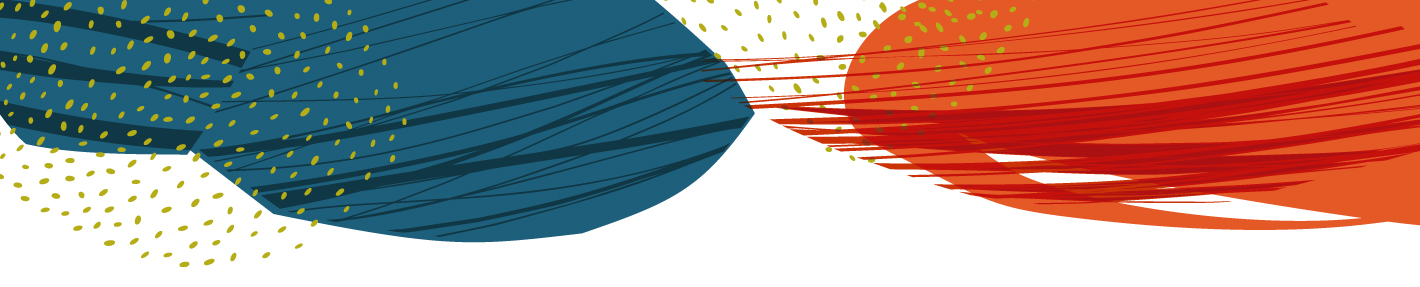L’ethnopsychiatrie est une discipline qui explore la manière dont les différentes cultures influencent la perception de la santé mentale, des troubles psychiques et des pratiques thérapeutiques. En psychomotricité, l’approche ethnopsychiatrique permet de mieux comprendre les liens entre le corps, la culture et la psyché. Elle offre une lecture plus large des troubles psychomoteurs en intégrant les croyances, les traditions et les représentations corporelles propres à chaque individu en fonction de son contexte culturel.
1. Qu’est-ce que l’ethnopsychiatrie ?
L’ethnopsychiatrie, développée entre autres par Georges Devereux (anthropologue et psychanalyste) et Tobie Nathan (ethnopsychiatre), repose sur l’idée que les troubles psychiques et les manifestations corporelles doivent être compris à travers le prisme culturel de la personne. Chaque culture possède ses propres représentations du corps, de la maladie, du soin et du rapport au monde.
Dans ce cadre, la psychomotricité, qui s’intéresse à l’articulation entre le psychisme et le corps, trouve un écho particulier dans l’approche ethnopsychiatrique. Elle permet d’explorer comment les représentations culturelles influencent :
- L’image du corps : Certaines cultures valorisent certaines morphologies ou attitudes corporelles, ce qui influence l’estime de soi et les postures adoptées.
- L’expression des émotions : Le rapport aux émotions varie selon les cultures, ce qui modifie l’expression corporelle des affects et la répartition des tensions.
- Les manifestations somatiques : les souffrances psychiques peuvent parfois s’exprimer par des symptômes corporels spécifiques à une tradition (douleurs, paralysies, tremblements) plutôt que par des plaintes verbales.
- Les croyances autour du soin : Certaines populations associent les troubles à des causes spirituelles ou sociales (possession, mauvais œil, rupture des liens familiaux), ce qui influence leur rapport aux soins médicaux et psychomoteurs.
2. Intégration de l’ethnopsychiatrie en psychomotricité
L’approche ethnopsychiatrique en psychomotricité implique une prise en charge adaptée à la diversité culturelle des patients, en tenant compte de leur perception du corps et du soin. Cela se traduit par plusieurs aspects, notamment :
a. L’écoute et la prise en compte du cadre culturel du patient et de son éventuel parcours migratoire
Un psychomotricien adoptant une approche ethnopsychiatrique va chercher à comprendre les croyances et les valeurs du patient à travers :
- Des entretiens approfondis permettant d’explorer le rapport au corps, à la maladie et au soin.
- Une observation des comportements corporels et des modes d’expression propres à la culture du patient.
- Une prise en compte des figures d’autorité et des rituels culturels qui influencent la perception et la compréhension du soin.
b. La compréhension des symptômes somatiques au regard des origines culturelles et transculturelles
Dans certaines cultures, les troubles psychiques s’expriment à travers des symptômes corporels, que l’on appelle parfois troubles somatoformes.
- Par exemple, une personne issue d’une culture où l’expression des émotions négatives est taboue peut développer des douleurs musculaires chroniques ou des sensations de paralysie.
- Certains patients présentent des troubles dissociatifs (exemple : crises de possession ou d’anesthésie corporelle) qui peuvent être interprétés sous notre référentiel occidental comme des troubles psychotiques majeurs et omettre une investigation plus spécifique en lien avec les psycho traumas.
En intégrant les principes de l’ethnopsychiatrie, la psychomotricité devient un véritable « soin métissé » entre le corps, l’histoire personnelle et l’identité (trans)culturelle du patient. Que se passe-t-il quand nos cultures du soin se rencontrent, coexistent, se métissent parfois ? Observer la dimension psychocorporelle des interactions multiculturelles devient précieuse pour mieux comprendre les enjeux identitaires des personnes exilées ou issus de parcours migratoires multiples…
Prise en charge du corps et soin de l’âme, de l’individu au collectif : composer, créer et métisser les outils thérapeutiques pour être au plus près de la souffrance du patient et de « sa berceau culturel ».
Pour compléter ce mémo, je vous conseille la lecture d’un article particulièrement intéressant paru dans Perspectives Psy 2022/4 – Vol.61 – Pages 353 à 360, intitulé « Tonus et culture, de la mémoire corporelle à la transparence corporelle. Une lecture transculturelle de la psychomotricité », co-écrit par S.HOUSSEINI-HOUY, H.CAMARA, M-R. MORO.
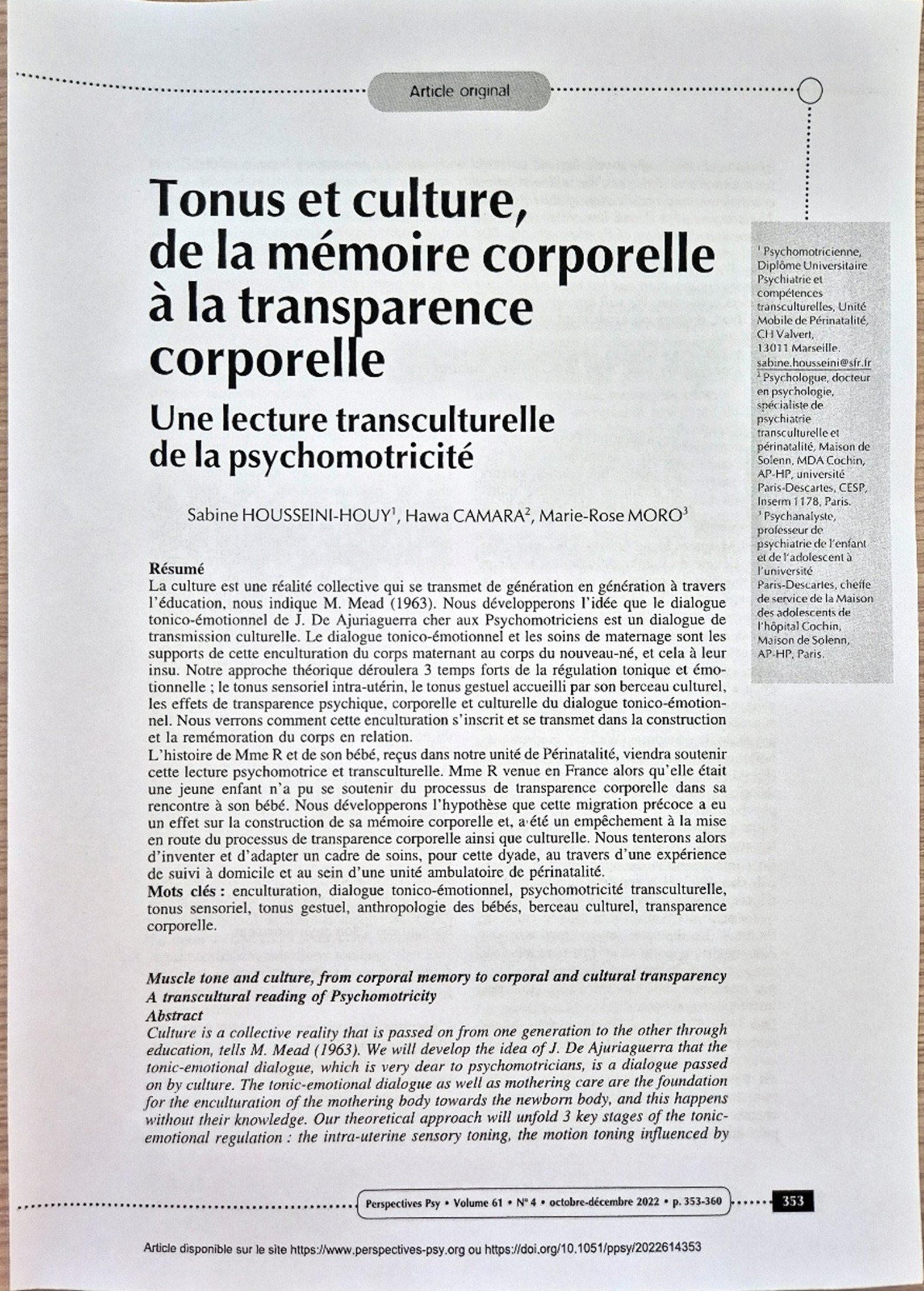
Belle lecture et beau voyage au cœur de ces notions de tonus sensoriel, tonus gestuel et dialogue tonico-émotionnel !